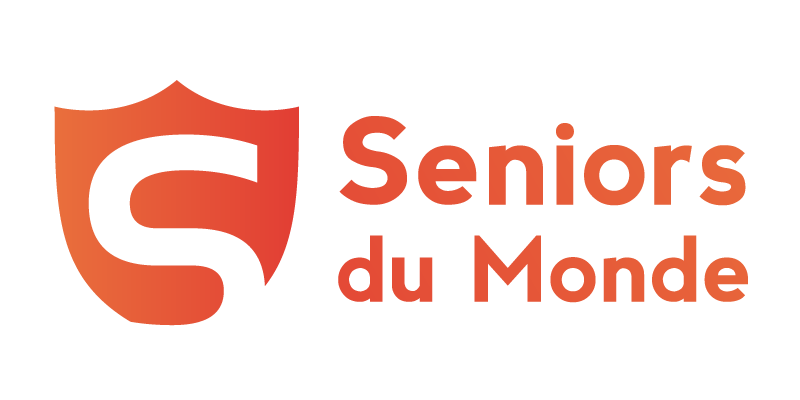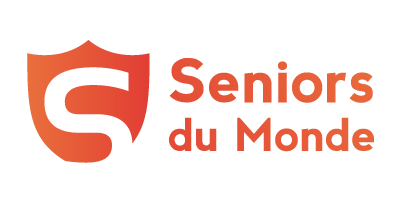Depuis la rentrée 2023, plusieurs établissements belges ont rayé les fêtes des mères et des pères de leur calendrier. Cette décision s’appuie sur des lignes directrices visant à éviter toute forme d’exclusion liée à la diversité des structures familiales.
L’abandon de ces célébrations soulève des interrogations parmi les familles, les enseignants et les élèves. Le débat met en lumière des enjeux complexes : préservation des traditions, adaptation à la réalité sociale et recherche d’équité dans l’environnement scolaire. Les conséquences de ce changement s’observent aussi bien dans la sphère privée que dans les pratiques éducatives.
Traditions familiales en Belgique : quelles appellations pour les grands-mères ?
En Belgique, les appellations des grands-mères se déclinent en une palette de mots qui racontent à leur façon l’histoire et la géographie du pays. À Bruxelles ou à Anvers, il n’est pas rare d’entendre un enfant appeler sa grand-mère Bomma ou Mémé. Plus au sud, du côté de Tournai ou dans la province du Luxembourg, les petits-enfants préfèrent souvent Bonne-Maman ou simplement Bonne. Ces choix ne tiennent pas du hasard : ils sont le reflet d’une identité familiale, d’un ancrage régional, parfois même du mélange des cultures qui caractérise la Belgique.
Un mot suffit parfois à faire revivre une étreinte, une recette partagée ou une leçon de vie. Les familles perpétuent ces usages, chacun à leur manière, selon leur langue ou leur histoire. Voici comment se traduisent ces appellations dans les différentes communautés du pays :
- Bomma (flamand),
- Mamy ou Mémé (francophone),
- Grossmutter (germanophone),
- Bonne-Maman ou son diminutif Bonne.
La fête des grands-mères ne tombe pas à la même date partout. En Belgique, c’est le premier dimanche de mars qui lui est dédié. Ce jour-là, la jonquille devient le signe de reconnaissance, la petite attention qui rappelle à chaque aînée qu’elle occupe une place singulière. Chez certains, cette fête rime avec un repas de famille, ailleurs avec des fleurs ou un simple appel téléphonique. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large, à la croisée des influences françaises et des traditions locales, où l’on célèbre le rôle de passeuse de mémoire, la capacité à transmettre des valeurs et des souvenirs.
La suppression des fêtes des mères et des pères à l’école : quelles raisons et quels enjeux ?
Au fil du temps, la disparition progressive des fêtes des mères et des pères à l’école marque une transformation profonde de la société. Ces événements rythmaient autrefois le calendrier scolaire, ponctués par des rituels devenus familiers :
- une carte décorée,
- un poème récité,
- un collier de pâtes confectionné avec application.
Mais le paysage familial s’est transformé. Beaucoup d’enfants grandissent aujourd’hui dans des structures où la notion de parent ne colle plus au modèle classique. Les écoles s’ajustent, conscientes de la nécessité de répondre à cette diversité familiale. L’enjeu de l’inclusivité s’impose : comment honorer chaque élève sans raviver des manques ou des blessures ? Entre l’unique parent mentionné sur l’acte de naissance, la présence de deux mamans, de deux papas, ou d’un tuteur légal, la célébration devient parfois un exercice d’équilibriste. Les enseignants cherchent à préserver l’équilibre du groupe tout en continuant à transmettre le respect et la gratitude.
Le débat va bien au-delà de l’organisation d’un atelier bricolage. Remettre en question ces fêtes, c’est toucher à la manière dont la société belge façonne ses repères et pense la transmission. À mesure que les modèles parentaux se multiplient, la fête des parents, ou celle des personnes chères, s’impose peu à peu. Cette transition suit une dynamique déjà observée ailleurs, notamment en France ou au Royaume-Uni, où l’école opte pour la neutralité et la reconnaissance de toutes les familles, quelles que soient leurs configurations.
La transmission des valeurs ne disparaît pas pour autant. Elle se métamorphose, s’adapte, reste vivante. La fête des grands-mères, célébrée en Belgique début mars, conserve toute sa charge affective, bien qu’elle épouse désormais les contours d’une famille en mouvement.
Quand les traditions familiales se heurtent à l’inclusivité : regards croisés sur l’évolution des rituels scolaires
Les rituels scolaires belges, longtemps porteurs d’une transmission familiale forte, traversent aujourd’hui une phase de redéfinition discrète. Les appellations des grands-mères et les célébrations autour des figures maternelles ou paternelles se frottent désormais à la réalité de l’inclusivité : familles recomposées, monoparentales, homoparentales, chaque situation invite à reconsidérer la façon de fêter. À Tournai, une directrice d’école raconte la complexité d’organiser une fête des mères lorsque, dans une classe, le spectre des histoires familiales oblige à mesurer chaque geste, à peser chaque mot.
Face à cette réalité, certaines écoles choisissent d’instaurer une fête des personnes chères. Cela permet à chaque enfant d’adresser un poème ou une carte à la personne qui compte à ses yeux, sans exclusive. À Anvers, une institutrice l’explique simplement : « Les enfants offrent un poème ou une carte à celui ou celle qui compte pour eux. Cela apaise les tensions, évite les mises à l’écart. » Ce changement répond à la volonté de ménager les sensibilités tout en maintenant la dimension symbolique de la fête.
La Belgique n’est pas seule à se pencher sur ces questions. Partout, de la France à l’Italie, du Royaume-Uni au Japon, les rituels scolaires se réinventent. La Mother’s Day américaine, la Festa dei Nonni italienne, le Keiro no Hi japonais : chaque pays adapte ses coutumes, jongle entre la fidélité aux traditions et l’ouverture à la diversité familiale. Parents et enseignants avancent ensemble, à la recherche de nouveaux repères pour maintenir le dialogue entre générations et préserver la singularité de chaque histoire.
Inventer de nouveaux repères : quelles alternatives pour préserver le lien intergénérationnel ?
La transmission des valeurs familiales suit parfois des chemins inattendus, surtout quand les rites évoluent. En Belgique, l’imagination des familles et des associations locales ouvre la voie à des alternatives qui renforcent le lien intergénérationnel. Renoncer à la traditionnelle carte de fête des grands-mères ne coupe pas le lien, il se tisse autrement, au gré des envies et des situations.
Voici quelques exemples concrets d’alternatives qui s’installent dans les familles :
- Repas en famille : brunchs, goûters partagés, recettes transmises de génération en génération créent des moments de complicité et de transmission.
- Ateliers créatifs : réalisation de cartes, albums photos, lettres manuscrites. Autant de supports pour faire revivre de beaux souvenirs ou raconter des anecdotes.
- Sorties culturelles : musées, promenades dans les Ardennes, découverte du patrimoine local ou participation à un événement de quartier. Autant d’expériences qui laissent une empreinte durable dans la mémoire collective.
Les petites attentions ne manquent pas : un bouquet acheté au marché, des douceurs maison, un jeu de société pour partager un après-midi à la maison de repos. Les associations locales multiplient les initiatives : ateliers cuisine, moments bien-être, rencontres intergénérationnelles où les histoires et les rires circulent librement entre anciens et plus jeunes.
La santé des aînés occupe aussi une place de choix. Des journées bien-être ou des séances de spa adaptées, parfois organisées par les familles ou en maison de repos, offrent à chaque génération l’occasion de s’accorder une pause douceur. Dans cette redéfinition des rituels, la créativité devient un moteur puissant de transmission des valeurs et de respect, dépassant largement le cadre d’une date marquée sur un calendrier.
Qu’il s’agisse de mots tendres, de gestes partagés ou d’initiatives collectives, la Belgique continue d’inventer, d’ajuster, de transmettre. Les repères changent, mais le lien reste : vivant, mouvant, prêt à s’inventer encore à la prochaine génération.