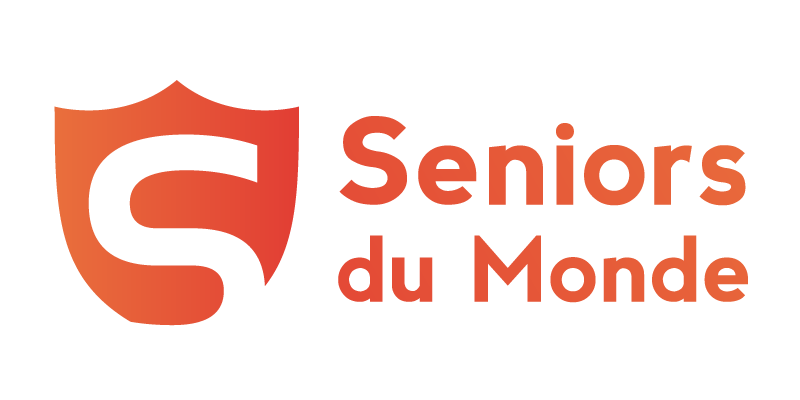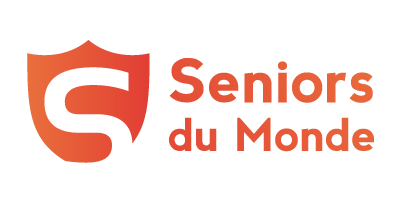En 2014, le Royaume-Uni a instauré une loi qui bouleverse la logique classique des politiques sociales : la prise en compte systématique de la vulnérabilité individuelle prime sur l’uniformité des dispositifs. Contrairement à la tradition, cette réforme impose aux institutions de repenser leurs pratiques en fonction des besoins réels, et non de simples catégories administratives.
Cette approche a généré des débats inédits sur la place de l’empathie, la reconnaissance de la dépendance et la hiérarchie des priorités collectives. Certaines critiques pointent une possible dilution des responsabilités publiques, tandis que d’autres y voient un levier de justice sociale renouvelée.
Quels sont les principes fondamentaux du care et pourquoi suscitent-ils autant d’intérêt ?
La notion de care s’inscrit dans une logique terre-à-terre du soin et de l’attention à autrui. Inspirée par les analyses de Carol Gilligan et Joan Tronto, elle s’affranchit des grandes constructions morales classiques pour plonger au cœur des réalités vécues par les personnes vulnérables. Ici, la condition humaine apparaît dans toute sa complexité, faite d’interconnexions et de parcours singuliers.
Le care ne se réduit pas à une série de gestes techniques ni à un simple métier. Il s’agit d’adopter une relation et une éthique centrées sur la reconnaissance de l’autre, sur la capacité à déceler les besoins particuliers, en toutes circonstances. Cette morale s’incarne dans l’action : écouter sans juger, adapter son attitude, reconnaître la vulnérabilité comme une réalité partagée par tous.
Pourquoi ce modèle attire-t-il autant l’attention ? Parce qu’il replace le soin et l’attention à autrui au cœur des discussions politiques. Il rappelle que l’existence humaine ne se résume pas à l’indépendance, mais se tisse dans un réseau de relations et de dépendances souvent passées sous silence. Cette perspective bouscule les choix collectifs et invite à revoir la politique du care autour du soutien, de la reconnaissance et du partage des responsabilités.
Les principes du care reposent sur un équilibre délicat : conjuguer universel et singulier, articuler règles générales et réponses adaptées à chaque situation. Ce balancier, à la fois précaire et prometteur, renouvelle la façon dont on aborde aujourd’hui les questions de soin, de relation et de morale.
L’éthique du care face aux autres courants : différences, convergences et débats
L’éthique du care s’est imposée comme un contrepoint vigoureux dans le paysage philosophique, remettant en jeu les bases mêmes de la justice et de l’autonomie. Face à l’approche libérale défendue par John Rawls, qui privilégie l’impartialité et les principes universels, le care fait le choix de la relation et de la responsabilité envers autrui. Carol Gilligan et Joan Tronto, figures majeures du mouvement, s’opposent ainsi à la vision morale strictement individuelle portée par Lawrence Kohlberg.
Malgré ces différences, la quête d’équité reste un terrain d’entente. Les tenants du care ne tournent pas le dos à la justice, mais interrogent ses modalités concrètes : l’impartialité, selon eux, risque d’ignorer les réalités de vulnérabilité vécues. Là où la tradition libérale érige l’indépendance en idéal, le care rappelle l’évidence parfois refoulée de la dépendance humaine et l’exigence d’un soutien quotidien.
La discussion reste animée. Des voix s’élèvent pour reprocher à l’éthique du care son ancrage dans la sphère privée ou son potentiel à consolider des rôles genrés. D’autres saluent sa capacité à injecter de la nouveauté dans la réflexion sur la responsabilité et l’attention. Progressivement, les frontières entre justice et care se brouillent, ouvrant la porte à des approches hybrides, capables de conjuguer principes universels et prise en compte des contextes particuliers.
Impacts du care sur la société : santé, éducation, politiques publiques
L’impact collectif et souvent invisible du travail du care irrigue toute la société. Dans les services hospitaliers, infirmières, aides-soignantes et travailleurs sociaux incarnent au quotidien cette éthique du soin. Leur engagement, trop rarement salué, forge une solidarité concrète auprès des personnes vulnérables : malades, personnes âgées, enfants fragilisés. Longtemps perçu comme l’apanage des femmes et des classes populaires, ce travail occupe désormais une place centrale dans les discussions sur la justice sociale.
La politique du care investit aussi le champ de l’éducation. L’école ne se contente plus d’instruire : elle accompagne, elle adapte ses méthodes, attentive aux besoins spécifiques de chaque élève. Les enseignants, confrontés à la diversité des profils, intègrent l’attention et la relation dans leur pratique. Cette évolution s’inscrit dans une réflexion plus globale sur la responsabilité collective envers les plus fragiles.
Quant aux politiques publiques, le care y trace sa voie peu à peu. Des rapports cités par Joan Tronto ou Sandra Laugier insistent sur l’urgence de repenser la place du travail du care dans la société. Plusieurs collectivités innovent avec des dispositifs visant à garantir dignité et autonomie aux personnes dépendantes. Le débat prend de l’ampleur : comment accorder enfin la juste reconnaissance à ce travail, encore trop souvent relégué derrière les priorités économiques traditionnelles ? Les défis sont nombreux, sur le terrain comme dans les institutions.
Le care en question : enjeux, limites et pistes pour penser l’avenir
La notion de vulnérabilité occupe une place centrale dans cette réflexion. L’éthique du care insiste sur la prise en compte des situations de dépendance et la diversité des besoins, sans jamais tomber dans le piège du paternalisme. Chaque trajectoire est unique, chaque contexte de soin réclame une réponse adaptée. Ce dialogue permanent entre universel et particulier rappelle que la solidarité ne s’impose pas d’en haut : elle se tisse, au quotidien, dans la relation.
Les réserves persistent. Certains voient dans la politique du care un risque de renforcer la division des rôles selon le genre ou la classe sociale. Le travail du soin, largement invisible, continue de reposer sur les épaules des femmes, des minorités, des personnes issues de milieux modestes. Comment sortir de cette logique ? Le débat reste ouvert, en France comme ailleurs. Des auteurs comme Nel Noddings ou Joan Tronto soulignent l’urgence de valoriser ces activités et d’élargir le cercle de celles et ceux qui prennent soin.
Pour envisager des changements concrets, plusieurs pistes se dessinent :
- Inscrire le soutien à la vie au centre des politiques publiques ;
- Donner toute sa place à la pratique du care dans la formation professionnelle et universitaire ;
- Favoriser de nouveaux espaces de dialogue réunissant soignants, aidants, personnes concernées et institutions.
Réparer le monde, selon les mots de Joan Tronto, commence par cette attention renouvelée à la fragilité humaine et ce partage plus juste du travail du soin. Le défi ne se limite pas à l’expertise : il engage chacun, là où il se trouve, à faire évoluer la société vers plus de reconnaissance et de solidarité.